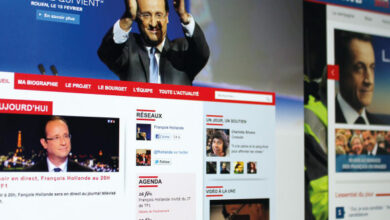Les sociétés occidentales traversent une panne d’avenir. Depuis plusieurs décennies, l’effritement des grands récits collectifs – progrès linéaire, émancipation par la technique, État-providence, croissance infinie, vertu universelle et pacificatrice du libre-échange – a laissé place à une fragmentation des imaginaires sociaux. La chute du mur de Berlin a marqué la fin d’une bipolarité géopolitique et idéologique. Les grandes utopies politiques qui structuraient les espoirs collectifs depuis les Lumières ne font plus recette.
Cette érosion narrative s’est accélérée avec la multiplication des crises : financière de 2008, urgence climatique, pandémie de Covid-19, retour de la guerre en Europe, révolutions numériques bouleversant le travail et les sociabilités. Chacune de ces épreuves remet en cause les anciens schémas explicatifs sans faire naître de nouvelles projections rassurantes sur l’avenir. Parallèlement, les cadres traditionnels d’intégration sociale – entreprises stables, classes sociales cohérentes, famille nucléaire, partis politiques de masse – se délitent, privant les individus de repères collectifs durables.
Dans ce contexte de désarroi, une quête de récits traverse l’espace public des sociétés contemporaines. Citoyens inquiets, responsables politiques, intellectuels : tous semblent confrontés à la nécessité de réinventer du sens collectif. En retour, de nouveaux récits émergent et s’affrontent dans l’arène publique. Certains puisent dans la nostalgie d’un passé idéalisé, d’autres dans les promesses d’une technologie salvatrice, d’autres encore dans le repli identitaire ou l’écologie radicale. Paradoxalement, nombre de ces narratifs émergents ont pour point commun une défiance envers les institutions démocratiques traditionnelles, qu’ils jugent impuissantes à répondre aux défis contemporains.
Cette situation inédite soulève des questions fondamentales : comment les sociétés fabriquent-elles du sens collectif en l’absence de grands récits fédérateurs ? Quels nouveaux imaginaires politiques émergent pour combler ce vide narratif ? Ces récits d’avenir reflètent-ils les aspirations profondes des citoyens ou sont-ils le produit de nouvelles formes de manipulation des opinions ? Comment s’articulent les angoisses individuelles et les projections collectives dans la construction des nouveaux mythes politiques ?
Cet appel à contributions (voir l’appel) s’adresse aux chercheurs de toutes les disciplines des sciences humaines et sociales : droit, sociologie, anthropologie, science politique, histoire contemporaine, économie, géographie, psychologie sociale, philosophie politique appliquée, littérature, sciences de l’information et de la communication.
Les contributions pourront s’appuyer sur des enquêtes quantitatives ou qualitatives, des analyses de discours, des ethnographies, des expérimentations participatives, des études de cas, des analyses comparatives, etc. L’objectif est de documenter empiriquement les processus de construction, circulation et réception des récits d’avenir.
Les études originales permettant d’apporter des éléments de réponse aux questions posées dans le projet scientifique (voir ici) seront particulièrement bienvenues.
Cet appel s’adresse aux enseignants-chercheurs, chercheurs et post-doctorants en début ou milieu de carrière, de toutes les disciplines des sciences humaines et sociales au sens large. Sont éligibles les personnes de toute nationalité et tout statut, rattachées à des institutions de recherche françaises (même si elles exercent à l’étranger) ou européennes et titulaires d’une thèse de doctorat.
Dans le cadre du programme, les contributions devront être déposées auprès de revues à comité de lecture. Parallèlement, une version destinée à un plus large public sera présentée en mars 2027 lors de la 14ème Journée des Sciences Sociales et fera également l’objet d’une publication en langue française dans l’ouvrage collectif de la Fondation. L’évènement sera précédé de trois journées de travail au cours desquelles les lauréats seront invités à discuter de leur projet d’article et à se former à la prise de parole.
Les candidats sélectionnés recevront, en fin de programme, un prix de 2500 euros.
Les inscriptions sont à présent clôturées.
La liste des chercheurs sélectionnés sera communiquée dans les prochaines jours.